Depuis près d’un siècle, la matière noire fait chauffer les méninges des physiciens et des astronomes. Indétectable directement, mais indispensable pour expliquer la cohésion des galaxies, elle reste, à ce jour, l’une des plus grandes énigmes de la cosmologie. Une nouvelle étude vient de proposer une piste très prometteuse pour faire avancer nos connaissances à son sujet : les exoplanètes, que nous découvrons par milliers depuis quelques années, pourraient servir de détecteurs naturels pour traquer cette substance invisible.
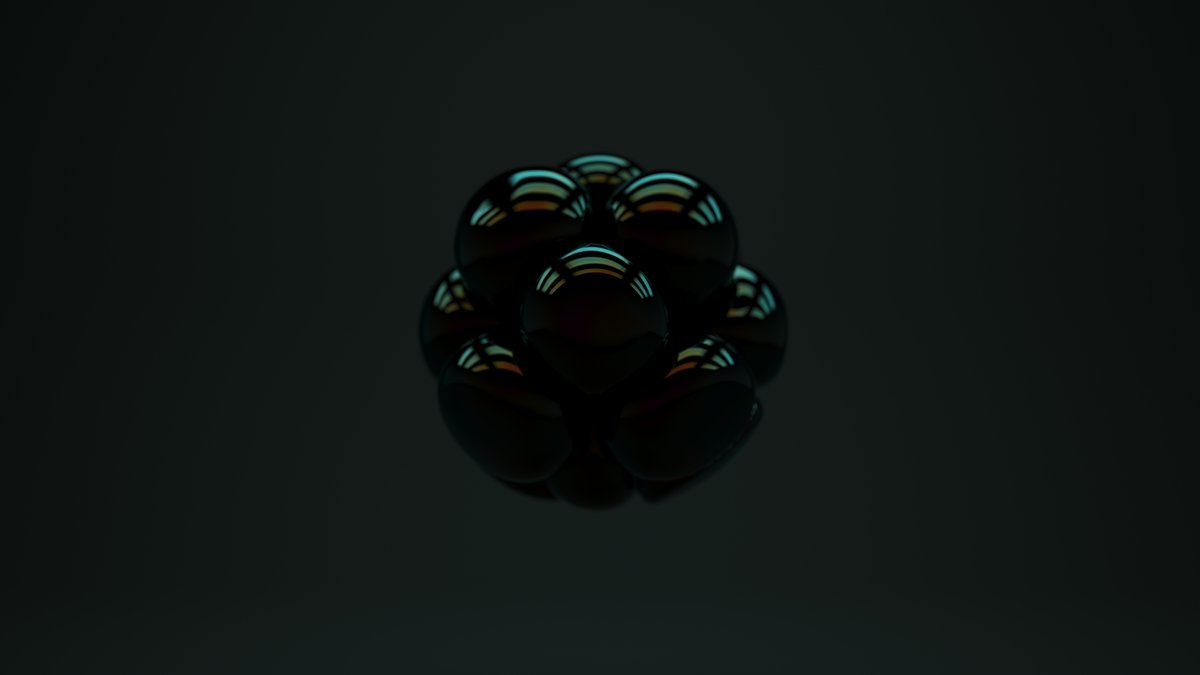
Impossible à observer à l’œil nu, elle échappe même à nos télescopes les plus puissants ; en effet, la matière noire ne se révèle que par son empreinte gravitationnelle. Pourtant, elle existe bel et bien puisque, sans elle, les galaxies telles que nous les voyons ne tiendraient pas ensemble : leurs étoiles se disperseraient dans l’espace. C'est le halo invisible de matière noire qui génère la gravité supplémentaire nécessaire pour maintenir ces dernières en orbite, permettant ainsi aux lois de la physique de Newton de rendre compte des observations à l'échelle galactique.
Les scientifiques estiment qu'elle représente 85 % de la matière totale de l'Univers, soit environ 27 % de son contenu global, le reste étant principalement de l'énergie noire (forme d'énergie hypothétique, elle aussi invisible, qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'Univers).
L'astronomie moderne, dans sa quête de la matière noire, s’est historiquement concentrée sur deux pistes principales : d'une part, la recherche de particules exotiques hypothétiques, comme les WIMPs (Weakly Interacting Massive Particle), et d'autre part, l'étude d'objets massifs compacts (MACHOs : naines blanches ou brunes, étoiles à neutrons, trous noirs, etc.).
Mais un champ d’exploration restait largement sous-exploité : celui des exoplanètes. Ces mondes en orbite autour d’autres étoiles, souvent des géantes gazeuses semblables à Jupiter, forment une population abondante et variée (plus de 5 000 déjà confirmés, dont la très prometteuse HD 20794 d).
C'est précisément sur ces objets célestes que des chercheurs de l’Université de Californie à Riverside ont porté leur attention. Selon leurs calculs, publiés dans la revue Physical Review D, les exoplanètes pourraient accumuler au fil du temps des particules de matière noire en leur cœur. « Si les particules de matière noire sont assez lourdes et ne s’annihilent pas, elles peuvent finir par s’effondrer en un minuscule trou noir », explique Mehrdad Phoroutan-Mehr, premier auteur de l’étude. Si ces chercheurs sont dans le vrai, les exoplanètes pourraient devenir des outils d'investigation cosmologique, afin que nous puissions réellement comprendre comment la matière noire interagit avec la matière ordinaire et, peut-être, identifier enfin ses particules.
Des planètes avalées de l’intérieur ?
Le modèle étudié ici est baptisé « superheavy non-annihilating dark matter », que l'on pourrait approximativement traduire en français par « matière noire superlourde non annihilante ». Dans ce scénario, les auteurs supposent que les particules de matière noire seraient extrêmement massives (bien plus que celles que nous connaissons en physique des particules) et qu'elles ne s’annihileraient pas entre elles lorsqu’elles se rencontrent. Contrairement à d’autres modèles où deux particules de matière noire se détruiraient mutuellement en produisant de l’énergie, ici, elles se contenteraient de s’additionner, comme les briques d'un mur empilées les unes sur les autres.
Ce qui, au fil de millions d'années, provoquerait une accumulation desdites particules dans le cœur des planètes géantes, piégées par leur gravité. Si la quantité réunie devenait suffisamment importante, cette masse atteindrait un point de non-retour : le noyau de la planète s’effondrerait alors sous son propre poids, donnant naissance à un trou noir miniature. « Ce trou noir pourrait croître et consommer la planète entière, devenant par conséquent un trou noir de la masse initiale de la planète », précise Phoroutan-Mehr.
Un tel scénario, s'il venait à être confirmé un jour, ouvrirait une brèche vertigineuse. Jusqu’ici, les trous noirs observés sont tous issus de la mort d’étoiles, avec des masses supérieures à celle du Soleil. Mettre la main sur un trou noir de masse planétaire reviendrait à découvrir une nouvelle espèce cosmique : une classe d’objets dont l’existence même bouleverserait nos théories et confirmerait que les planètes peuvent piéger la matière noire au point d’en être englouties.

Observer les planètes pour débusquer l’invisible
L’intérêt de l’étude est qu’elle va au-delà du scénario théorique pour proposer des pistes tangibles pour vérifier l’hypothèse qu'elle avance. Si la matière noire agit réellement sur les exoplanètes, ses effets pourraient se manifester de plusieurs façons. En s’accumulant dans leur cœur, elle pourrait dégager de la chaleur supplémentaire, modifier leur stabilité interne, voire provoquer l’émission de rayonnements énergétiques détectables à distance.
Aujourd’hui, nos instruments ne sont malheureusement pas encore capables de distinguer de tels signaux, trop faibles ou confondus avec les variations inhérentes à l’environnement spatial. Une situation qui, heureusement, pourrait rapidement changer.
Les prochaines grandes missions d’observation, comme celles du satellite européen PLATO de l'ESA ou du télescope spatial Roman de la NASA (même si son avenir ne s'annonce pas radieux), auront la sensibilité nécessaire pour mesurer plus nettement la structure et l’évolution de ces planètes lointaines.
« Ces résultats montrent comment les relevés d’exoplanètes pourraient être utilisés pour chasser les particules de matière noire superlourdes, en particulier dans les régions supposées riches en matière noire, comme le centre de notre galaxie », souligne Phoroutan-Mehr.
À l’inverse, le simple fait que Jupiter, tout comme d’innombrables exoplanètes de masse comparable, existe encore sous forme de planète et non de trou noir donne déjà de précieuses contraintes aux chercheurs. Si cette fameuse matière noire superlourde non-annihilante s’accumulait aussi vite que certains modèles le prédisent, ces géantes gazeuses auraient dû s’effondrer depuis longtemps. Leur stabilité actuelle permet donc d’écarter certains scénarios trop extrêmes et de resserrer l’éventail des hypothèses.
Comme le souligne Mehrdad Phoroutan-Mehr, « découvrir une population de trous noirs de masse planétaire constituerait une avancée majeure » : cela validerait au contraire l’existence d’un mécanisme capable de transformer une planète en trou noir miniature, et nous donnerait une preuve directe du rôle joué par la matière noire.
Notons là toute l'ambivalence de la méthode d'investigation adoptée : ce qui n’existe pas encore observé compte autant que ce qui pourrait apparaître. Pas de trous noirs planétaires ? Alors, certains modèles deviennent caducs. Une poignée de détections dans la prochaine décennie ? La matière noire superlourde deviendrait l’une des meilleures candidates pour résoudre cette grande énigme. Après tout, n'est-ce pas ainsi que progresse la science ? En acceptant que le doute et la réfutation soient aussi importants que la confirmation. C'est ainsi depuis Galilée : une hypothèse ne vaut que tant qu’elle survit à l’épreuve des faits.
Sources : Futurity, Physical Review D

