Une équipe de chercheurs a observé une étoile revenir deux ans après une première rencontre avec un trou noir supermassif. L’éruption détectée ressemble trait pour trait à celle enregistrée lors du premier passage.

- Une étoile a survécu à une rencontre avec un trou noir supermassif, provoquant deux éruptions lumineuses similaires en 2022 et 2024.
- Les chercheurs pensent que l'étoile a échappé à la destruction totale grâce à son noyau dense, résistant à la spaghettification.
- Ces événements rares offrent un aperçu des forces gravitationnelles extrêmes autour des trous noirs, enrichissant notre compréhension cosmique.
L’événement a été repéré par l’observatoire de Las Cumbres, un réseau de télescopes capable de suivre les phénomènes cosmiques rapides. Une étoile, déjà passée au large d’un trou noir supermassif en 2022, a provoqué une seconde éruption lumineuse au même endroit deux ans plus tard. Les deux sursauts sont si proches, dans leur forme comme dans leur intensité, que les scientifiques pensent qu’il s’agit de la même étoile. Cette hypothèse va à l’encontre des scénarios habituellement retenus, car une telle interaction gravitationnelle est censée provoquer la destruction totale de l’étoile. Or ici, les observations suggèrent que l’objet céleste aurait survécu à une première « spaghettification », avant d'y replonger.
Une étoile aurait survécu à une première déformation extrême avant de revenir
Les chercheurs pensaient avoir déjà tout vu du côté des trous noirs, depuis la première image du M87* en 2019. Ils avaient tort. Une étoile vient d’échapper deux fois de suite à l’étreinte gravitationnelle d’un trou noir supermassif, situé à environ 400 millions d’années-lumière de la Terre. Le phénomène, observé en 2022, a été suivi d’une seconde éruption en 2024 au même endroit. Et les données montrent que les deux événements sont quasiment identiques.
C’est ce qui a poussé les astronomes à formuler une hypothèse peu orthodoxe selo laquelle la même étoile serait revenue, deux ans plus tard, pour une nouvelle interaction avec le trou noir. Elle n’aurait pas été totalement détruite lors de son premier passage.
« L’étoile n’est pas une boule uniforme », a précisé Iair Arcavi, chercheur à l’université de Tel Aviv, cité par Mashable. « Sa partie externe est plus pelucheuse, elle peut donc être arrachée plus facilement. Si l’étoile est passée à la bonne distance, il est possible que son cœur plus dense ait survécu », a-t-il ajouté.
Les deux éruptions, appelées événements de perturbation par effet de marée, ont été détectées par l’observatoire de Las Cumbres. Cet ensemble de télescopes robotisés est conçu pour capter des phénomènes brefs mais intenses dans le ciel. Après avoir comparé les courbes de lumière, les chercheurs ont exclu d’autres causes comme une lentille gravitationnelle ou deux sources distinctes.
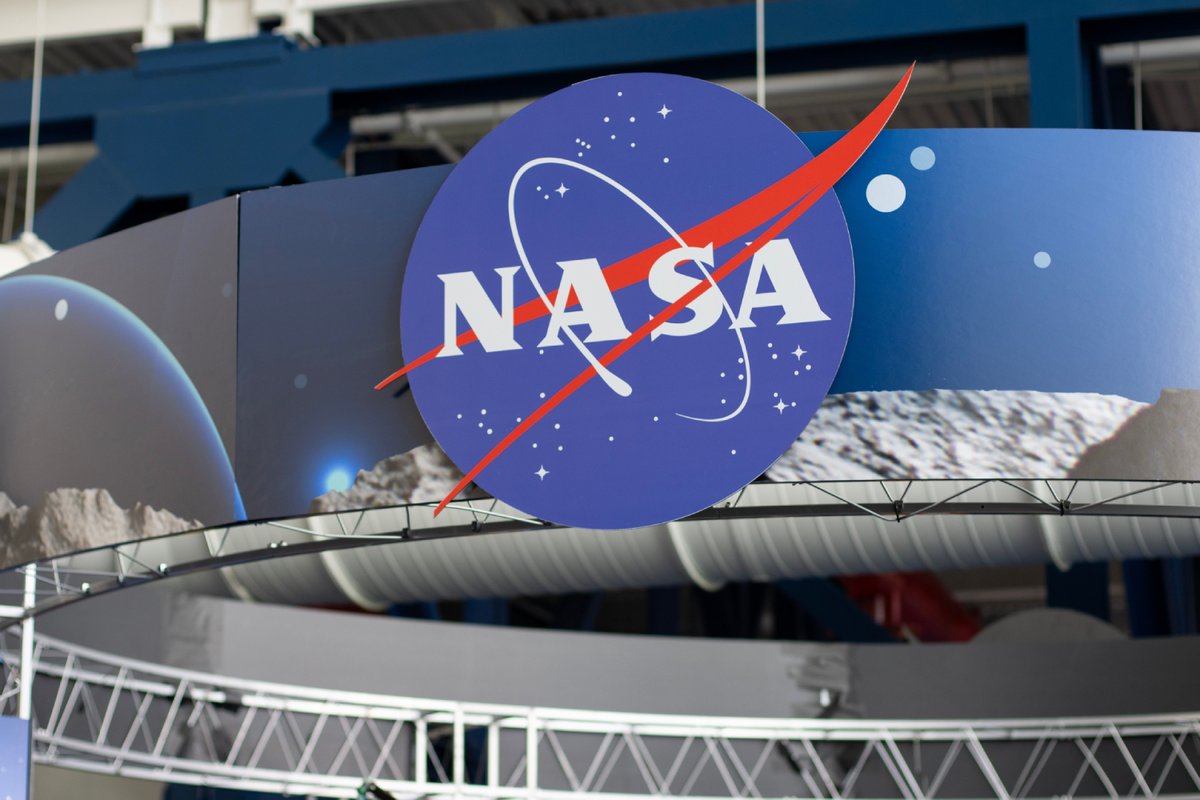
Le phénomène de spaghettification n’est pas toujours synonyme de destruction complète
Lorsqu’une étoile s’approche d’un trou noir, elle subit des forces de marée extrêmes. Le phénomène, surnommé « spaghettification », a été popularisé par Stephen Hawking dans son livre Une brève histoire du temps. Les forces gravitationnelles étirent l’étoile sur son axe, jusqu’à la transformer en un long filament de matière.
En théorie, cette déformation va jusqu’à la dislocation complète. En réalité, tout dépend de sa densité. La NASA rappelle que les parties internes d’une étoile sont souvent plus compactes que ses couches externes. Certaines étoiles peuvent donc résister partiellement à ce type de rencontre, selon leur structure.
Des simulations menées par le Goddard Space Flight Center montrent que les étoiles peu denses se désintègrent rapidement. Les plus denses peuvent, elles, se contenter de perdre une partie de leur enveloppe avant de repartir. Cette variabilité rend chaque interaction avec un trou noir imprévisible.
Dans le cas étudié ici, la première interaction aurait retiré une partie du gaz de surface. Le noyau, plus compact, aurait poursuivi sa trajectoire sans franchir l’horizon des événements. Deux ans plus tard, l’étoile serait revenue sur une orbite similaire, avec à nouveau une émission lumineuse très marquée.
Depuis avril 2019, les astronomes disposent d’une image réelle d’un trou noir. Elle a été captée par l’Event Horizon Telescope, un réseau mondial de radiotélescopes. Mais l’intérieur du trou noir reste inaccessible. En revanche, ce type d’événement de perturbation donne un aperçu indirect des forces qui s’y déchaînent. Selon la NASA, plus de 100 de ces événements ont été détectés à ce jour dans des galaxies proches.
