On pensait avoir percé une bonne partie des mystères de notre voisine rouge : un désert glacé, une atmosphère extrêmement tenue et quelques traces d'anciennes rivières, disparues aujourd'hui. Néanmoins, les données de la mission InSight viennent nous prouver qu'il nous manquait une grosse pièce du puzzle martien.

En 2018, lorsque la sonde InSight s'est posée sur la surface roussie de Mars, elle avait pour objectif d'écouter battre le cœur de la planète grâce à ses sismomètres. En quatre ans d'activité, elle a pu capter des séismes secouant la planète, ce qui lui a permis par le même temps de sonder ses entrailles.
Grâce à elle, nous avons su que le noyau de Mars était liquide, ce qui, en soi, était déjà une grande révélation. Une étude plus récente, publiée le 3 septembre dans la revue Nature, menée par Huixing Bi (Université des sciences et technologie de Chine) et ses collègues, vient de nous apporter un véritable scoop. Sous la couche liquide de ce noyau se cache… un noyau interne solide, exactement comme celui de notre belle planète bleue.
C'était une question qui taraudait les scientifiques depuis des années : la planète rouge avait-elle une structure géologique interne comparable à la nôtre ? Était-elle capable de générer, dans le passé, un champ magnétique protecteur comme celui de la Terre ? Ce noyau de 610 km de rayon prouve peut-être que Mars a pu, dans ses jeunes années, abriter une véritable « dynamo » interne, le moteur de son champ magnétique disparu.
Pourquoi est-ce si important ? Car une planète possédant un champ magnétique a pu un jour conserver une atmosphère plus dense, propice à l'existence de l'eau liquide et potentiellement protectrice pour d'éventuels êtres vivants primitifs. Sans ce bouclier, les vents solaires frappent directement la haute atmosphère, arrachant peu à peu les particules de gaz et les projetant dans l’espace. Un processus appelée érosion atmosphérique, tellement puissant qu'il peut transformer une planète tempérée et humide en un désert froid et sec comme Mars l'est aujourd'hui. Comprendre pourquoi Mars a perdu son magnétisme, c'est aussi comprendre un grand chapitre de son histoire géologique : le moment où son noyau interne a cessé d’alimenter sa dynamo planétaire, ce qui l'a conduite à devenir le monde inhospitalier qu'explorent les rovers Perseverance ou Curiosity.
Le mystère du champ magnétique perdu
Le cœur de la Terre est composé d’un noyau interne solide entouré d’une enveloppe liquide. La différence de température et de composition entre ces deux zones crée ce qu'on appelle des mouvements de convection. En circulant dans ce fluide métallique conducteur, ces courants produisent un champ magnétique : c’est l’effet dynamo. Ce champ agit comme une protection, détournant les particules solaires et préservant notre atmosphère, condition essentielle à l’habitabilité de la planète.
Les roches martiennes gardent la mémoire d’un ancien champ magnétique, preuve qu’il y a plusieurs milliards d’années, la planète rouge possédait sa propre protection ; un champ qui a fini par s'éteindre peu à peu. Une hypothèse avancée par les chercheurs est que le noyau de Mars, enrichi en éléments légers comme le soufre ou le carbone, serait resté liquide trop longtemps. Dans ce cas, la cristallisation nécessaire pour alimenter une dynamo interne n’aurait jamais pu se déclencher. En juillet 2021, une étude dirigée par Simon Stähler de l'ETH Zurich allait déjà dans ce sens : à partir des données de la mission InSight, son équipe avait décrit un noyau totalement liquide, dense, mais sans cœur solide, ce qui pouvait expliquer la disparition de l’ancien magnétisme martien.
En exploitant de nouveau les enregistrements sismiques d'Insight, l'équipe de Huixing Bi a réussi à clarifier la situation. Ils ont identifié des ondes traversant la limite entre le noyau liquide et un noyau interne solide, apportant la première preuve directe de son existence. Pour y parvenir, les chercheurs se sont appuyés sur des séismes particulièrement favorables à ce type de détection et ont affiné leurs méthodes d’analyse pour isoler des signaux voilés.
Une découverte qui fait taire le débat qui divisait les chercheurs : ceux qui pensaient que le noyau de Mars était entièrement liquide, sans partie solide en son centre, et les autres, qui soupçonnaient l’existence d’un noyau interne cristallisé. Mars possède donc bien un noyau interne cristallisé, ce qui confirme qu’elle a pu générer un champ magnétique dans son passé, avant que sa taille réduite et son refroidissement rapide n'interrompent ce mécanisme.
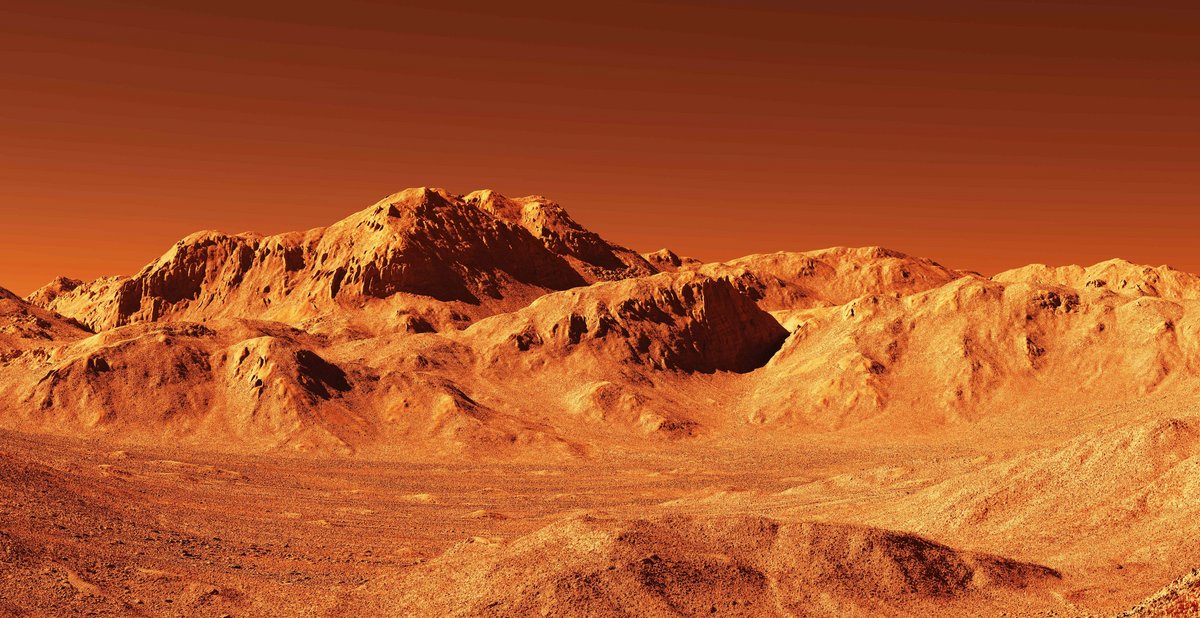
Le rôle décisif du noyau dans le destin des planètes
Si l'on extrapole cette découverte au-delà du cas martien, elle touche à une question essentielle en planétologie : quelle masse une planète doit-elle avoir pour garder un noyau capable de soutenir un champ magnétique sur le long terme ? La Terre, plus grande, conserve encore une dynamo interne qui protège son atmosphère, et par conséquent, la vie à sa surface. Mars, environ deux fois plus petite que la Terre, l’a perdu. Vénus, pourtant de taille comparable à la Terre, est complètement dépourvue de champ magnétique : c'est bien le signe que d’autres facteurs entrent en jeu.
La taille d’une planète ne détermine donc pas, à elle seule, la présence ou non d’un champ magnétique. La composition du noyau, la manière dont la chaleur est évacuée vers le manteau et la surface, ou encore sa vitesse de refroidissement sont autant de facteurs qui déterminent si une dynamo peut se maintenir dans le temps.
InSight, malgré son arrêt en 2022, nous a permis d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'histoire géologique de Mars, sans toutefois la refermer complètement. De nouvelles missions, on l'espère, parviendront à nous fournir d'autres précieux éléments de compréhension. Sonder la composition de ce noyau et retracer la chronologie de sa cristallisation, pour peut-être, enfin répondre à la question ultime qui hante les astronomes : depuis quand Mars a-t-elle cessé d'être une planète vivante ?
Source : The Conversation
