Il existe, au centre de la Voie lactée, un rayonnement gamma que rien ne semble pouvoir expliquer ; nous l'observons pourtant depuis près de 20 ans. S'il pourrait émaner d'étoiles à neutrons à rotation rapide (pulsars millisecondes), certains physiciens suggèrent qu'il est, tout aussi probablement, le produit énergétique de la matière noire elle-même. C'est, à ce jour, peut-être l'indice le plus prometteur jamais découvert de son existence.

Depuis 2008, le télescope spatial Fermi-LAT de la NASA analyse les rayons gamma, ces photons de très haute énergie produits lors des phénomènes les plus violents de l’Univers. En cartographiant la Voie lactée, notre galaxie, cet observatoire en orbite a détecté un excès de rayonnement (GCE) en son centre. Si certaines sources comme les supernovas ou le trou noir supermassif Sagittarius A* n'expliquent pas cette émission, les chercheurs peinent encore à trancher entre deux hypothèses également probables : les pulsars millisecondes (une forme d'étoile à neutrons) ou la matière noire.
Cette dernière théorie vient d’être solidement étayée par une étude publiée le 16 octobre dansdepuis le 16 octobre, jour de parution d'une étude dans la revue Physical Review Letters, menée par Moorits Muru du Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (AIP). À l’aide de superordinateurs, son équipe a reconstruit le passé gravitationnel de la Voie lactée, en simulant les innombrables fusions de mini-galaxies qui ont bâti sa structure actuelle. Ces événements auraient densifié le halo de matière noire dans cette région, créant un contexte idéal pour que des collisions entre particules engendrent le GCE que les instruments de Fermi détectent depuis des années.
« La matière noire domine l’Univers et maintient les galaxies ensemble. C’est extrêmement important, et nous réfléchissons sans cesse à la façon de la détecter », explique Joseph Silk, coauteur de l’étude et astrophysicien à Johns Hopkins University, également affilié à la Sorbonne Université et au CNRS.
Ces simulations ont permis d’obtenir une « carte de densité » de matière noire dont la répartition coïncide presque parfaitement avec les observations gamma du télescope Fermi. Cette concordance suggère fortement que le GCE provient bien des collisions de particules de matière noire ; un indice très solide, mais insuffisant pour écarter l'hypothèse des pulsars millisecondes selon les chercheurs.
Pulsars ou matière noire : qui éclaire vraiment le centre galactique ?
Il ne s'agit donc pas encore d'une preuve formelle ; d'autres phénomènes astrophysiques pourraient tout aussi bien produire un signal lumineux comparable. Comme expliqué précédemment, les pulsars millisecondes sont les premiers candidats, capables d'émettre des rayons gamma d’une intensité comparable à celle détectée par Fermi-LAT. Ce sont des étoiles à neutrons très anciennes qui se sont formées il y a des milliards d'années.
Après avoir épuisé leur énergie, elles sont « recyclées » ou « réactivées » en accrétant la matière d’une étoile voisine. Ce regain d’énergie les fait tourner à une vitesse vertigineuse, les transformant en pulsars millisecondes qui libèrent des rayons gamma d’une intensité telle qu’ils peuvent être confondus avec ceux que pourrait émettre la matière noire.
Le principal écueil de cette hypothèse tient à la quantité de sources nécessaires : pour reproduire le rayonnement observé, il faudrait postuler l’existence de centaines de pulsars millisecondes encore non détectés. Une population de « fantômes » qu'aucun de nos télescopes n'a jamais observée ; une hypothèse difficile à concilier avec nos relevés actuels.
Inversement, la piste de la matière noire, elle, semble se suffire à elle-même. Si ses particules s’entrechoquent réellement dans le cœur galactique, l’énergie libérée correspond exactement au signal que Fermi enregistre depuis quinze ans. Il n'y aurait là aucunement besoin d'imaginer l'existence d'une population de pulsars théoriques.
Si ce scénario s'avère juste, encore faut-il identifier la nature de la matière noire qui pourrait produire un tel signal. C'est pourquoi les chercheurs, dans leur étude, évoquent les WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles) : des particules hypothétiques qui n’interagissent que très faiblement avec la matière baryonique présente dans l'Univers (protons, neutrons, électrons).
Proposées à la fin des années 1970, les WIMPs sont devenues depuis le modèle de référence pour expliquer l'existence de la matière noire. Dans les zones les plus denses du halo galactique, ces particules pourraient parfois entrer en collision ou s’annihiler mutuellement, libérant une grande quantité d’énergie sous forme de rayons gamma. Ce rayonnement ne trahirait pas la présence des WIMPs à proprement parler, mais l’énergie libérée par leur annihilation. Il s'agit donc d'une trace lumineuse d’un phénomène détecté de manière indirecte.
Justement, les simulations menées par Muru et son équipe montrent que lorsque lorsque l'on applique leur nouvelle distribution morphologique de la matière noire, la carte simulée du rayonnement gamma reproduit presque parfaitement celle observée par le télescope Fermi. Le profil énergétique des WIMPs correspond bien aux données réelles, sans qu'il soit nécessaire d'additionner d'autres sources émettrices. Si cette corrélation entre les simulations et les données réelles existe bel et bien, l'équipe de Muru serait à l'origine de la première détection indirecte crédible de la matière noire dans l’histoire de l’astronomie.
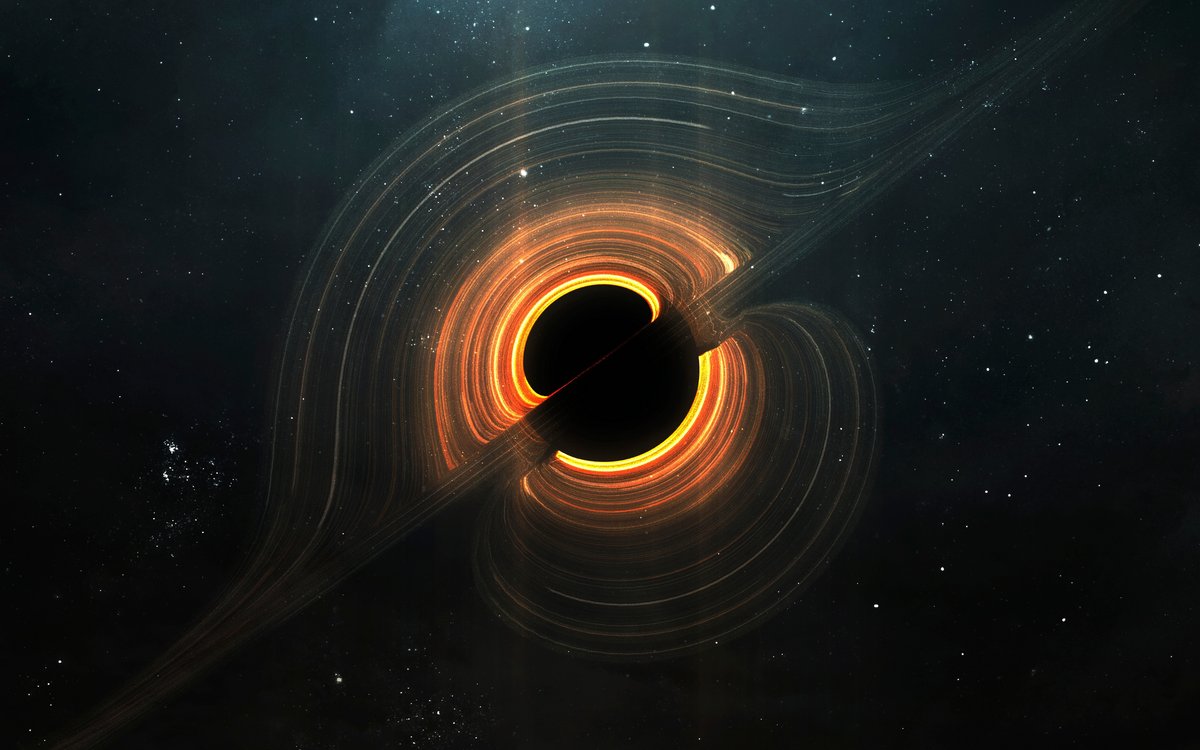
Cherenkov : l’instrument qui pourrait faire parler la lumière ?
Pour départager les deux hypothèses, les chercheurs se tournent vers le Cherenkov Telescope Array (CTA), un réseau de télescopes actuellement en construction, conçu pour détecter les rayons gamma à des énergies bien plus élevées que ceux mesurés par Fermi. Sa plus grande sensibilité permettra de distinguer les signatures énergétiques des pulsars de celles que produiraient des collisions de particules de matière noire.
Les chercheurs comptent aussi confronter leur modèle à d’autres environnements : les galaxies naines qui gravitent autour de la Voie lactée, réputées pour leur forte concentration de matière noire et leur faible activité stellaire. Si un excès de rayonnement gamma y est détecté par CTA, il ne pourrait guère être attribué qu’à la matière noire elle-même.
Modérant toutefois son enthousiasme, Silk admet : « Il est possible que nous confirmions une théorie plutôt qu’une autre, ou que nous ne trouvions rien du tout. Dans le cas contraire, l’énigme ne ferait que s’épaissir. » Cette phrase résume à elle seule la principale difficulté à laquelle doit faire face la cosmologie moderne : la majorité des phénomènes structurant notre cosmos nous échappent, car nous sommes incapables de les observer directement. Une impasse expérimentale, dont la matière noire est certainement le symbole le plus caractéristique.
Si l'étude de Muru n'a pas apporté la preuve de son existence, attendue avec grande hâte par tous les astrophysiciens, elle aura au moins fourni le modèle prédictif le plus abouti jamais été élaboré pour la sonder. Fritz Zwicky, Vera Rubin, et tous ceux qui l'ont défendu contre le scepticisme général auraient sans doute sauté de joie s'ils avaient pu constater qu’une étude a su donner corps à une idée qu’ils avaient défendue envers et contre tous.
Source : Johns Hopkins University
